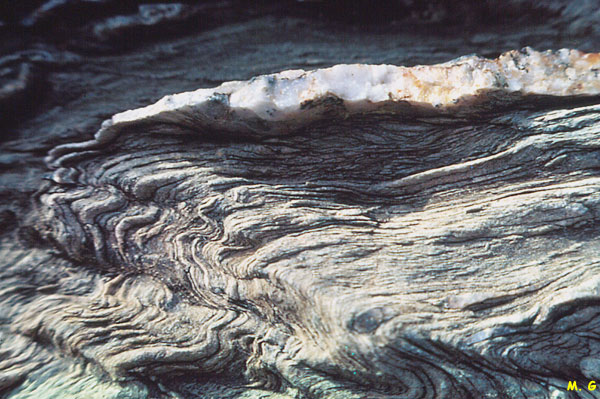
Phyllades plissés de l'île du Gaou (le Brusc) avec un lit de quartz
Il est formé de terrains anté-carbonifères comme les phyllades du Massif de Sicié et de terrains carbonifères comme les schistes houillers du Bassin des Playes à Six-Fours.

Au sommet, la chapelle Notre Dame de Bonnegarde et une antenne de télévision.
La roche qui constitue pour l'essentiel ce massif est une
roche, grise à patine rousse qui présente des feuillets d'épaisseur
inférieure à 5 mm, appelée phyllade (sorte de schistes).
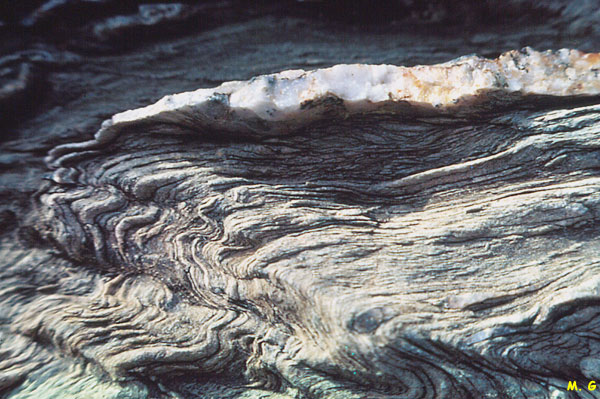
L'observation montre que le phyllade est formé
- de lits durs et clairs riches en quartz de petite taille
(parfois ce minéral a cristallisé dans des fentes en lits épais et souvent
plissés, on parle alors de quartzophyllades, c'est le cas ici)
- des lits gris et tendres formés de minéraux argileux et de micas
blanc pour l'essentiel.
Un simple broyage dans l'eau suivi d'un temps de repos laisse voir des
débris grossiers mais aussi des sables riches en grains de quartz blancs
et durs, des minéraux argileux onctueux au toucher et des paillettes
brillantes de mica.
En conclusion: le phyllade est formé de matériaux
détritiques (de détritus = débris) qui proviennent de
la destruction, suite à l'érosion, de roches antérieures.
Les phyllades sont des roches riches en silicates d'alumine hydratés (1).

En effet, ils sont souvent plissés et se débitent en dalles le long de plans privilégiés (surfaces de schistosité), parallèles entre eux et parallèles à l'axe du pli.
1= surface
de stratification (qui séparait 2 couches sédimentaires)
2 = schistosité (surface qui
apparaît à la suite de contraintes ici latérales convergentes).
Ces déformations ont affecté ces terrains postérieurement à leur formation
et sont le résultat de l'action de forces orientées ou contraintes
consécutives au rapprochement de plaques qui constituent l'enveloppe de la
Terre (4) et qui donnent naissance à certains types de chaînes de montagnes.
Les phyllades sont d'anciennes
roches argilo-sableuses d'origine marine puisqu'on a trouvé dans
les quartzophyllades du massif du Fenouillet à Hyères, des schistes
noirs riches en matière organique contenant des graptolites,
fossiles marins datés du Silurien moyen (Ere primaire il y a environ 440
millions d'années) (2).
La présence de plis, de microplis et d'associations (ou paragénèses) de
minéraux microscopiques caractéristiques (chlorite, muscovite, séricite,
biotite...) attestent que les phyllades sont d'anciens sédiments
(sables, argiles) transformés ou métamorphisés (sous la double influence
de températures peu élevées < 500° C et de contraintes ou pressions
dirigées de type métamorphisme
de basse intensité correspondant aux
conditions de l'anchizone et de l'épizone définies par les géologues)
(3).
A propos de ces roches métamorphiques, on parle de "faciès des schistes verts" car elles sont riches en chlorite qui est un phyllosilicate hydraté ferromagnésien de couleur verte
En rapprochant les données recueillies en
(1), (2), (3) et (4) on peut avancer l'idée que les phyllades proviennent
de formations rocheuses ayant subi plusieurs cycles orogéniques
successifs (processus aboutissant à la formation de chaînes de montagnes)
provoquant des déformations et des métamorphismes associés qui constituent
le socle (a) du département.
Sur un vieux socle (> 600 millions d'années) s'est
déposé au Primaire, en milieu marin, du matériel
détritique entre 500 et 350 millions d'années comme des sables, des
argiles, du quartz et des restes de graptolites (-440 millions d'années).
Puis émerge de l'océan, le continent pyréno-corso-sarde
(lors d'une période de convergence de plaques au cours de la formation de
la chaîne hercynienne (il y a 330-320 millions d'années, ère primaire) qui
subira, avec sa couverture sédimentaire, érosion intense et métamorphisme
donnant en particulier des phyllades remontés aujourd'hui en surface.
Après le dépôt de sédiments charbonneux (Les
Playes-Six-Fours, Stéphanien environ -300 Millions d'années) au
Carbonifère, s'accumulent sur des épaisseurs considérables au Permien (fin
du Primaire, -250 millions d'années) et au Trias (début du Secondaire)
des grès et des argiles rouges d'origine continentales et lagunaires (grès
bigarrés (b), calcaires et marnes à gypse de la
Pointe du Bau Rouge à Sanary). Ces sédiments qui s'entassent dans la
dépression qui va de Sanary à Saint-Raphaël, proviennent de l'érosion de
la chaîne hercynienne. Ils constitueront le tégument
(c) qui restera solidaire du socle lors des mouvements tectoniques
ultérieurs.
Pendant le reste du Secondaire, dans la mer alpine se
forment les calcaires jurassiques et crétacés marins et récifaux qui
formeront l'ossature des Massifs nord-toulonnais (Mont Caume, Coudon,
Faron, Gros Cerveau) constituant la couverture (d) qui dès la fin
du Secondaire (Maestrichtien -70 millions d'années) puis à la fin de
l'Eocène (Tertiaire) a été plissée, décollée du tégument et déplacée en nappes
ou en écailles comme en témoignent les Chaînons nord
Toulonnais qui chevauchent vers le nord, les terrains du Bassin de Bandol
(Haug 1925) qui recouvrent au ceux du synclinal du Beausset ou encore la klippe
du Vieux Beausset (portion d'une unité tectonique isolée par
l'érosion et venant en recouvrement sur des terrains plus récents).
Le socle de la région a lui aussi été affecté par les
mouvements tectoniques successifs notamment les phyllades du Massif de
Sicié, qui recouvrent le Permien et le Trias de
La Verne-Fabrégas extrémité ouest de la dépression permienne ; ces
phyllades ne se sont pas formés sur place mais constituent une véritable
nappe de socle venue en recouvrement et déversée vers le nord
(Mattauer et Prost 1963). Les lambeaux de phyllades à l'est de Toulon (le
Mourillon, Cap Brun, La Malgue, le Pradet) sont considérées comme des klippes
(restes de nappe isolées par l'érosion).
A l'Oligocène-Miocène le vieux massif pyrénéo-corso-sarde
s'effondre; au Miocène s'ouvre la Méditerranée.
Au Tertiaire et au Quaternaire, la chaîne alpine subit une érosion
intense.

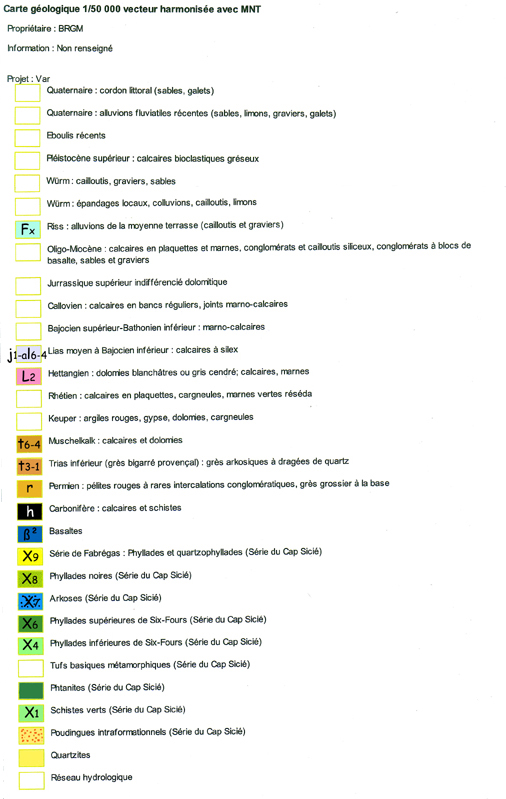
Liens a,b,c,d = cf. Panorama géologique