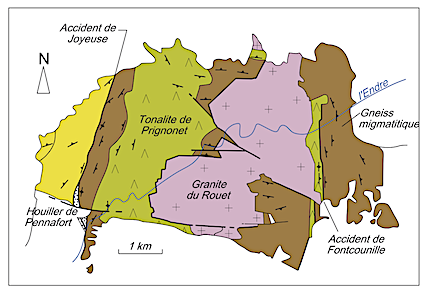
Fig. 2. Carte schématique de l'antiforme du Rouet
d'après Toutin-Morin et al. (1994); Onézime et al. (1999); Rolland et al. (2009).
Après le péage du Muy, sur l'autoroute Toulon-Nice prendre la D25 en direction de Sainte-Maxime, puis la D74 en directionde Plan-de-la-Tour.
1.1. Mode de gisement.Le Massif
des Maures et le massif du Tanneron présentent des structures
analogues et des formations magmatiques et métamorphiques
équivalentes (Creveola et Pupin, 1994).
En effet le granite de Plan de la Tour (Maures) et le granite du
Rouet (Tanneron) sont de même type; ils se présentent sous la forme
de petits massifs au sein d'antiformes limités par des failles,
accident de Gimaud-Pennafort (Maures), accidents de Joyeuse et de
Fontcounille (Tanneron).
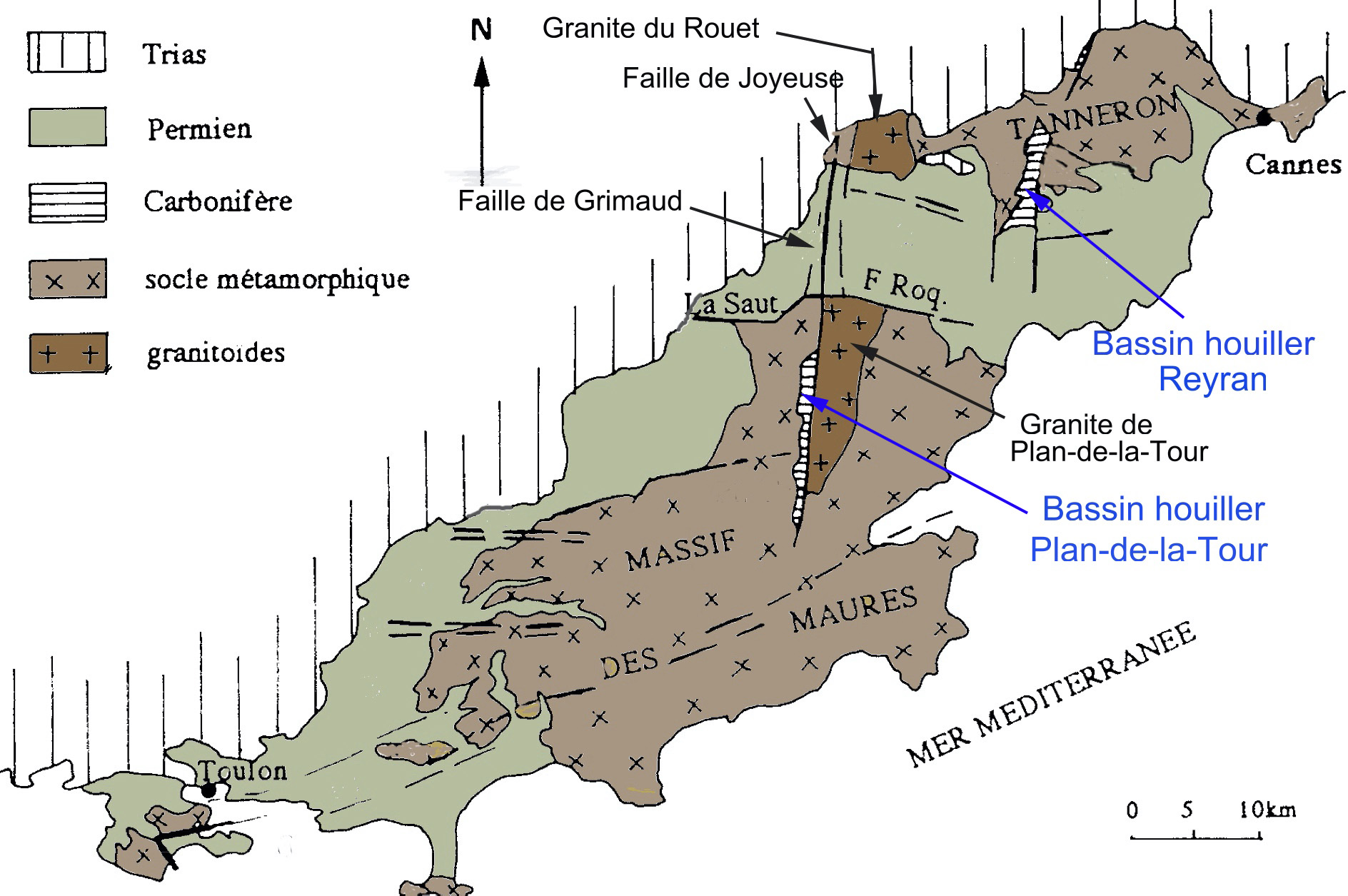
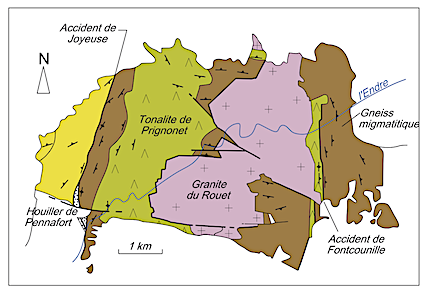
Ces granites sont limités par des accidents tectoniques.
La faille de Grimaud, dans les Maures, qui se prolonge par
la faille de Joyeuse dans le Tanneron, sépare les Maures
orientales (migmatites) des Maures centrales
(micaschistes et gneiss migmatitiques). La faille de
Lagarde-Freinet sépare les Maures centrales des Maures
occidentales (phyllades, micaschistes et gneiss de
Bormes).
Les
granites sont intrusifs dans les tonalites et les
migmatites. Le rejeu des failles a provoqué l'apparition
de fossés d'effondrement comblés par des formations
détritiques charbonneuses (Houiller de Plan-de-la-Tour et
du Reyran, de Pennafort et du Tanneron) .

A gauche arkoses de Roquebrune, au centre zone de roches broyées, à droite granite de Plan-de-la-Tour.
La faille, avec un
pendage de 70° vers le nord, se trouve dans une zone de
plusieurs mètres de large injectée de filonnets de
quartz et de barytine.

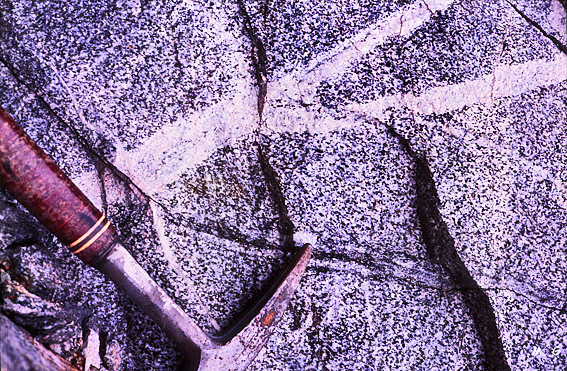

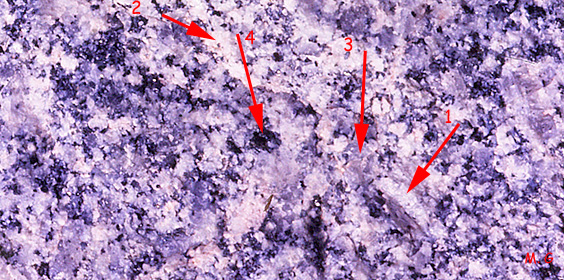

Le granite de Plan-de-la-Tour est une roche grenue,
entièrement formée de cristaux de grande taille
(holocristalline porphyroïde):
-mica noir (biotite) brillant, clivable, brun jaune en
lumière polarisée,
-mica blanc (muscovite),
-feldspath potassiques orthose blanc ou rose, gris
bleu en lumière polarisée, mâclé en cristaux de grande
taille (plusieurs cm),
-feldspath sodicalciques plagioclases (oligoclase et
andésine),
-quartz, gris à éclat gras, blanc avec extinction en
lumière polarisée,
-cordiérite peu abondante..
Les proportions de feldspaths alcalins et de
plagioclases étant à peu près égales on parle de monzogranite.
En observant une lame mince on note la présence de
cristaux de biotite à l'intérieur de cristaux de
feldspath bien formés ce qui n'est pas le cas des
cristaux de quartz; l'ordre de cristallisation est
donc le suivant: mica, feldspath et quartz.
En conclusion
: le granite est issu d'un magma qui
a donné des filons qu'on retrouve dans les
migmatites de Reverdi lors de sa mise en place; un
magma qui a cristallisé lentement (gros cristaux
d'orthose) en profondeur et qui postérieurement a
été aussi traversé par des "jus circulants", des
fluides minéralisateurs, comme l'attestent les
nombreux filons.
1.2.2. Le granite
du Rouet
C'est aussi uranite alumineux de feldspath orthose, de
biotite, de quartz et de gros cristaux souvent altérés,
vert sombre de cordiérite (silicate alumineux
ferro-magnésien).
 1.3. Origine du magma granitique
1.3. Origine du magma granitique
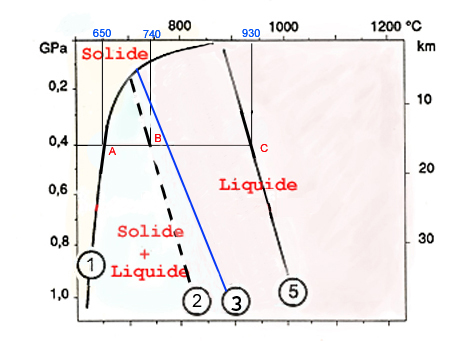
Le granite contient plusieurs types d'enclaves; les enclaves de migmatites qui sont d'anciens gneiss de la croûte continentale partiellement fondue en présence d'eau; feldspath et quartz donnant un magma granitique et le résidu (micas notamment) donnant un magma non miscible formant des enclaves surmicacées.


Par contre, les enclaves de tonalites proviennent d'un magma calco-alcalin d'origine mantellique.
Le granite de Plan-de-la-Tour est donc un granite
hybride formé d'un
mélange de deux magmas, un magma d'anatexie
crustale et un magma calco-alcalin mantellique
différencié.
Ce granite associé à des roches métamorphiques en est le terme ultime, l'anatexie ou fusion partielle de la croûte continentale.
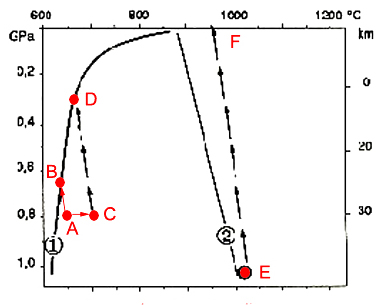
Un magma granitique d'anatexie crustale (A) récemment formé a une densité inférieure au solide qui lui a donné naissance et a donc tendance à remonter vers la surface; mais il rencontre très rapidement les conditions de solidification en (B) sur la courbe du solidus et forme donc un massif de migmatites ou d'anatexites en profondeur.
S'il y a une surchauffe (C) dans un contexte
tectonique, sa migration peut se poursuivre vers la
surface et donner naissance à un massif granitique à
bords circonscrits ou pluton,
en (D), intrusif dans les roches qu'il traverse.
Lors de sa migration le magma a pu utiliser les fractures de l'écorce terrestre, former un batholite
sans auréole de métamorphisme de contact car il
a migré à travers des roches formées à haute
température et émettre des filonnets dans
l'encaissant.
Dans les Maures, sur
le front de taille de la carrière de Reverdi on
peut observer les différents granitoïdes c'est le cas du granite de Plan-de-la-Tour et du Rouet qui sont des granites
diapirs ou intrusifs
qui ont plus ou moins "digéré" les roches traversées
(subsistant sous forme d'enclaves qui
se mettent en place successivement dans le socle migmatitique des Maures.

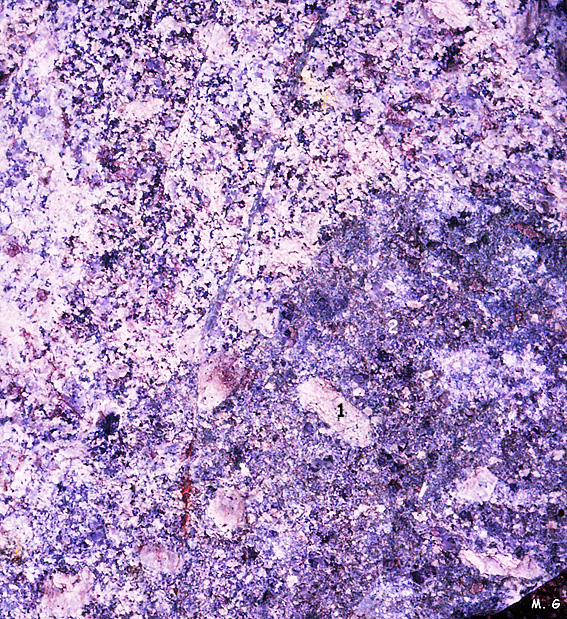
Fig. 15. Enclave
acide de migmatites (2) à gros cristaux de feldspath
(1) dans le granite de Plan-de-la-Tour
3. Le granite de
Plan-de-la-Tour.
Au centre sur la photo (Fig. 14)
traversé par un filon d'aplite clair.
4. Les filons d'aplite.

L'aplite est un granite clair (leucocrate) à grain
fin (quartz+Feldspath abondants+éléments
ferro-magnésiens peu abondants). Il forme les
bordures, une coupole qui coiffe le granite et des
filons qui recoupent le granite de Plan-de-la-Tour
ou la tonalite Ces filons d'aplite sont issus de jus
résiduels de fin de cristallisation du batholite
granitique.
5. Les filons de pegmatite.
La pegmatite est un granite à gros cristaux
(Quartz+Feldspath orthose+grenats) de même origine
que l'aplite mais qui a subi un refroidissement lent
6. Les cumulats.
Ce sont des granitoïdes à gros
cristaux maclés Carlsbad, d'orthose provenant de la
cristallisation fractionnée du magma dont les gros
cristaux se sont sédimentés par gravité dans la
poche magmatique; ils contiennent des enclaves
basaltiques sombres à structure microlitique.
7. Autres filons sombres à
l'ouest de la carrière.
7.1. filons de dolérites.
Ce sont des basaltes alcalins doléritiques (à texture microgrenue) provenant de la fusion du manteau mis en place au Permien dans un contexte tectonique de divergence, en effet ces filons recoupent toutes les roches précédentes.

Fig.17. Filon de basalte
doléritique (1) recoupé par un filon de
rhyolite (2) dans le granite de
Plan-de-la-tour.
Le premier est plus ancien
que le second.
7.2. Filons de ryolithes.
Les rhyolites vertes ou rouges sont des roches extrusives, des roches magmatiques acides, de composition granitique, dévitrifiées ou pyromérides.
| Tonalite de Reverdi | 344 Ma | U-pb |
Moussavou (1998) |
| Granite Plan-de-la-Tour | 329 ± 5 Ma | U-Pb sur monazite | Moussavou, (1998) |
| Granite Plan-de-la-Tour | 329 ± 3 Ma | U-Th-Pb sur monazite | Oliot et al. (2015) |
| Granite Plan-de-la-Tour (Nord Grimaud) | 301,6 ± 1 Ma | 40Ar/39Ar | Morillon et al. (2000) |
| Granite Plan-de-la-Tour (Reverdi) | 304 ± 3 Ma | 40Ar/39Ar | Morillon et al. (2000) |
| Granite du Rouet | 301,8 ± 2,7 Ma | U-Pb sur monazite | Demoux et al. (2008) |
| Granite du Moulin Blanc | 301 Ma | U-Pb sur zircon et monazite | Duchesne et al. (2013) |
| Granite de Camarat | 298 ± 8 Ma | Rb/Sr sur roche totale | Amenzou (1988) |
Remarque: localement les tonalites et les granites auraient pu être rajeunis par des fluides hydrothermaux circulants, ce qui expliquerait les différences de datation.
Compte tenu de leur âge les granites des Maures et du Rouet appartiennent à des batholites différents, mis en place dans les tonalites plus anciennes, dans des contextes tectoniques semblables à des stades différents. Compte tenu que la mise en place d'un batholite se fait en moins de 1 Ma, le granite de Plan de la Tour se serait mis en place il y a environ 305 Ma et le granite du Rouet il y a 302 Ma vraissemblablement comme ceux de la presqu'île de Saint-Tropez d'après G.Crévola. Le granite de Camarat serait le dernier pluton mis en place il y a 299-300 Ma dans les gneiss œillés migmatitiques de Saint-Tropez datés de 301-302 Ma.
Les granites de Plan-de-la-Tour et du Rouet seraient donc les témoins d'une phase tardive de fusion crustale lors de 2 stades différents d'exhumation de la Chaîne varisque.
G. Crévola, dans "Quelques
structures remarquables du Granite du Rouet,
de sa mise en place intrusive passive puis
de sa déformation transpressive tardive"(
Riviera Scientifique Octobre 2016), montre
que la bordure ouest du granite du Rouet est
limitée par une zone à pegmatite à
stockscheiders, à gros cristaux
pluricentimétriques de feldspaths potassiques
qui se sont développés perpendiculairement au
contact.
<<Deux mécanismes, sans doute
additifs, sont généralement proposés pour
expliquer leur développement :
-individualisation des fluides par
refroidissement du magma contre une paroi
froide qui vont faciliter la cristallisation
de pegmatites -contraction du magma en cours
de refroidissement, suivant des fractures
perpendiculaires au contact qui vont guider la
croissance des cristaux.>>
D'aprés Pitcher (1993) ces zones de contact
sont typiques de la mise
en place de manière passive ou permissive
de granitoïdes qui remplissent une cavité de
l'encaissant ménagée lors d'une subsidence
crustale par le jeu de failles prééxistantes.
G. Crévolar a montré qu'un deuxième type de
structures tectoniques remarquables s'observe en
bordure occidentale du granite du Rouet, le
découpage de bancs rocheux parallèles, en
lentilles imbriquées, sigmoïdales,
amygdalaires ou rectangulaires en dominos; elles
seraient caractéristiques d'une déformation
transpressive, elle même insérée dans une
structure en
fleur due au jeu de l'accident de Joyeuse.

Cette zone aurait subi une transpression, c'est à dire un cisaillement oblique, un décrochement dextre avec un raccourcissement supplémentaire et simultané qui induit un épaississement vertical du bloc central, de la croûte continentale.
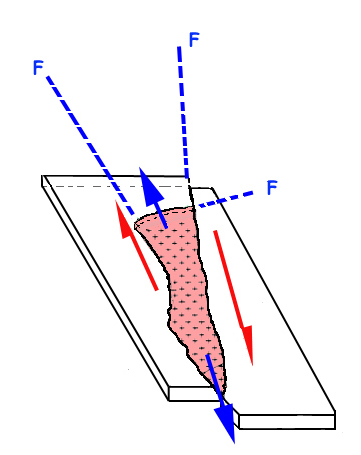
Fig. 20. Décrochement dextre
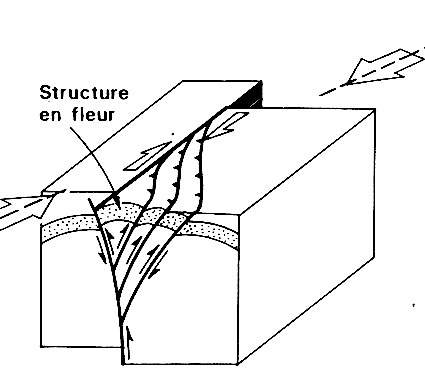
Fig. 21. Structure
en fleur
Extrusion verticale de matériaux dans une faille décrochante formant une structure en fleur.
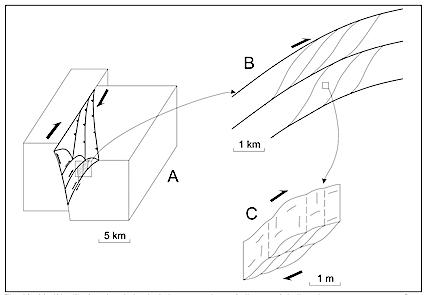

Au niveau de l'accident de Grimaud, la bordure du granite de Plan-de-la-Tour montre, des mirroirs de faille avec stries de friction, des mylonites (véritable purée minérale de roches broyées (cf. fig. 3), des indices de déformation cisaillante confirmées par l'étirement et l'orientation des cristaux de quartz (Onézime et al. 1999).


Ces déformations qui affectent le bassin houiller de
Plan-de-la-Tour daté de 305 millions d'années environ,
lui sont donc postérieures.
Elles correspondent aux derniers stades de
l'exhumation du socle provençal.
Le granite, roche ignée profonde a été mis à nu suite aux effets de plusieurs phénomènes comme l'érosion, l'isostasie, la fusion des parties profondes de la croûte, le dégagement de chaleur provoquée par des désintégrations radioactives ou encore le basculement du socle.

Fig. 26. Exhumation et mise à nu d'un batholite
La collision suite à une compression latérale entraîne un épaississement de la croûte continentale, l'érection d'une chaîne de montagnes et une surcharge qui provoque une rupture d'équilibre isostatique entre la lithosphère et l'asthénosphère sur laquelle elle "flotte"; l'érosion active et des mouvements compensatoires verticaux provoquent un amincissement crustale, une extension et un aplanissement progressif jusqu'à un effondrement gravitaire et l'exhumation des formations profondes comme les migmatites ou les plutons de granitoïdes.



Peu à peu, sous l'action de l'érosion qui entraine l'arène granitique, les amas de blocs se transforment en chaos de boules de granite.

Au préalable on se
reportera au chapitre consacré au "Massif
des Maures et l'ororogénèse varisque".
C'est au cours du Dévonien
et du Carbonifère que suite à plusieurs phases de
compression au cours de l'orogène varisque associé à un
métamorphisme du vieux socle (gneiss) et de la
couverture que se mettent en place les grandes
structures du Massif des Maures dont l'accident de
Grimaud-Pennafort qui sépare l'unité de Bormes est et
l'unité de La Garde-Freinet (schistes, quartzites,
micaschistes), des unités des gneiss orientaux
(migmatites et granites).
C'est à la suite d'une subsidence
crustale et par le jeu des failles
préexistantes dont la faille de Grimaud-Pennafort
que se met en place, de manière passive, dans une cavité
aménagée dans une croûte fragile, le granite de
Plan-de-la-Tour. Dans des circonstances semblables va
débuter et se poursuivre l'histoire du Granite du Rouet
et des failles de Joyeuse et Fontconille dans le
Tanneron.
Au Carbonifère moyen des fossés
d'effondrement apparaissent le long de l'accident
de Grimaud-Pennafort lors d'une phase de distension
normale pour certains géologues ou apparaissent, en
contexte coulissant (décrochement dextre) en transtension
avec cisaillement et extension délimitant des bassins
de type "pull apart" pour d'autres
géologues.
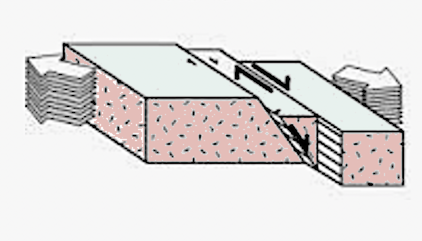

C'est dans ce contexte que
se met en place le batholite granitique de
Plan-de-la-Tour le long de l'accident de
Grimaud-Pennafort; puis les intrusions d'aplite formant
la coiffe et la bordure du massif et les structures de
refroidissement à pegmatites à gros cristaux de
feldspath.
Le batholite du Rouet
aurait une histoire semblable.
Les arkoses permiennes
accumulées dans le fossé carbonifère ouest-est de
Roquebrune-sur-Argens qui bordent ce massif au Nord,
renferment des galets de granite du Plan-de-la-Tour donc la mise en place du batholite est antérieure à la
limite du Carbonifère-permien il y a 325 Ma
environ.
Plus tard le rejeu
de la faille de Grimaud, consecutif à une transpression
avec raccourcissement, provoque une extrusion
verticale et l'apparition de structures
remarquales, structure en fleur et lenticulation
(Fig. 21 & 22).
Au Carbonifère supérieur,
la jeune chaîne hercynienne subit une érosion
active et les fossés se comblent de formations
détritiques charbonneuses donnant naissance aux bassins
houillers de Plan-de-la-Tour, du Reyran
(Wesphalien supérieur et Stéphanien inférieur).
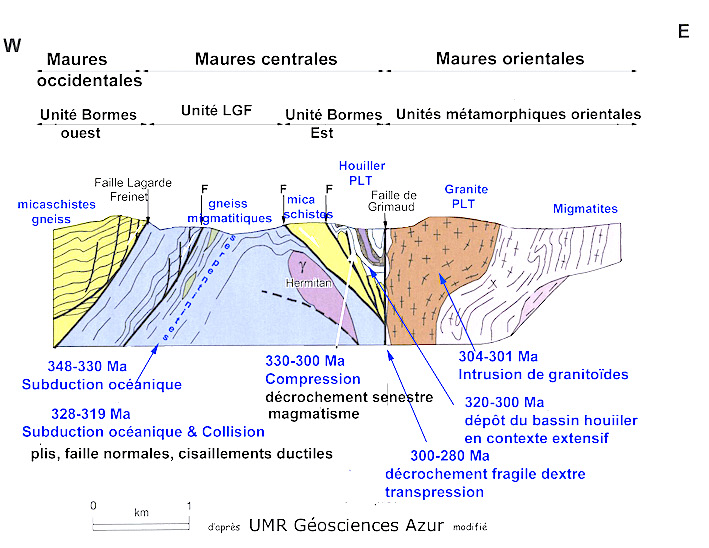
Au Permien inférieur lors d'une phase
de distension N-S, stade initial de rifting
contiental annoncant l'ouverture de la Thétys,
se forment de vastes dépressions au NE (fossé de
l'Estérel), au nord et à l'ouest de l'actuel Massif
des Maures (dépression permienne), et des failles E-W.
Au Permien supérieur au cours d'une phase de
distension le batholite de Plan de la-Tour est scindé
en deux par le fossé EW de Roquebrune-sur-Argens.
Un magmatisme bimodal de type rift
(filons de basaltes doléritiques) et filons de
rhyolites fluidales vertes est associé à cette phase
de distension.
Pendant toute cette période l'érosion se poursuit
comblant les dépressions de la région et notamment le
fossé de Roquebrune-sur-Argens vaste cône de déjection
dont les arkoses renferment des galets de granite.
 |

|
 |
Maj 16.05.2020 & 12.08.2021